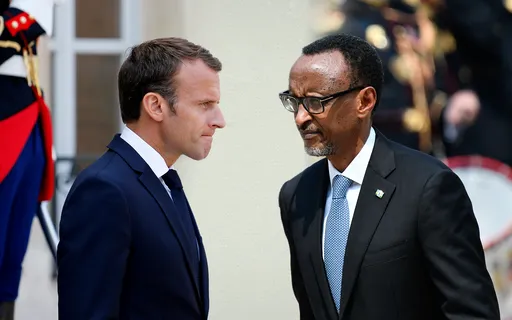Par Hinda Abdi Mohamoud
Alors que les cycles apparemment sans fin de sécheresses, d'inondations et de conflits continuent de frapper la population somalienne, un nombre croissant de personnes fuient vers les périphéries des zones urbaines, en particulier la capitale Mogadiscio.
Les Nations unies estiment qu'à l'échelle mondiale, d'ici 2026, plus de personnes vivront dans les villes que dans les zones rurales. Mogadiscio serait la deuxième ville du monde dont la croissance est la plus rapide, en grande partie à cause de l'afflux massif de personnes déplacées, dont 79 % sont des femmes et des enfants.
Selon un rapport de l'ONG Refugees International, la plupart des millions de personnes fuyant les zones rurales vers les zones urbaines en Somalie ne rentreront pas chez elles, ni maintenant, ni jamais. Certains vivent dans des camps de fortune depuis plus de trente ans.
Parmi les 4,3 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays, beaucoup doivent trouver de nouveaux moyens de subsistance. La plupart d'entre elles ont vécu en tant qu'agriculteurs et éleveurs. Leurs compétences ne leur permettent pas de gagner leur vie en ville. C'est pourquoi ils doivent tout recommencer à zéro.
Fatima Mohamed Iise, 31 ans, est arrivée dans le camp de déplacés d'Asal en juin 2023 avec ses sept enfants. Ce camp, qui abrite environ 800 familles, est l'un des plus récents établissements créés à la périphérie de Mogadiscio.
Elle a fui le district de Qoryoley, dans la région du Lower Shabelle, au sud de la Somalie, après que la sécheresse a tué tout son bétail. Son mari est resté sur place pour protéger leur maison et les quelques biens qui leur restent.
Travailler dans des restaurants
« Nous menions une très bonne vie en tant qu'éleveurs. Nous avions environ 40 vaches », explique-t-elle. « Maintenant, nous n'en avons plus, alors je n'ai pas eu d'autre choix que de venir à Mogadiscio avec mes enfants ».
Aucune aide humanitaire n'était disponible pour Iise et sa famille lorsqu'elle est arrivée au camp d'Asal. Elle a paniqué car elle ne savait pas comment se nourrir ou nourrir ses enfants. D'autres femmes arrivées dans le camp avant elle l'ont encouragée à se rendre dans les quartiers environnants pour y chercher du travail.
« Ma fille de neuf ans et moi sortons tôt tous les matins pour chercher du travail », dit-elle. « Les seuls emplois que nous trouvons sont la blanchisserie et le nettoyage des chantiers de construction, qui rapportent entre 1 et 1,50 dollar par jour. Ce n'est pas suffisant pour payer les produits de première nécessité, mais c'est mieux que rien du tout ».
« Nous n'avons que des compétences rurales et personne n'en a besoin en ville », ajoute -t-elle.
Les camps de personnes déplacées situés à la périphérie de Mogadiscio sont gérés par des gestionnaires de quartiers informels, connus localement sous le nom de « gardiens », qui servent d'intermédiaires entre les résidents des camps et les acteurs extérieurs.
Les résidents du camp d'Asal n'ont pas d'emploi régulier. Comme Iise et sa fille, elles sortent tous les matins à la recherche d'un travail journalier. Les formes de travail les plus courantes que les femmes trouvent sont le nettoyage des maisons, la lessive et la vaisselle dans les restaurants.
Les enfants commencent à travailler dès l'âge de quatre ou cinq ans. Les filles font la vaisselle, les garçons cirent les chaussures ou travaillent dans des restaurants.
L'argent irrégulier qu'ils gagnent, entre 1 et 2 dollars par jour lorsqu'ils trouvent du travail, les enferme dans un cycle de pauvreté.
Au-delà de l'imagination
« J'utilise mes gains pour acheter du riz, des haricots ou de la farine de maïs. Nous mangeons une fois par jour, à l'heure du déjeuner », confie Iise. « Le reste du temps, nous buvons du thé. Mes enfants et moi nous endormons l'estomac vide ».
Comme d'autres femmes déplacées, Iise est confrontée au harcèlement des hommes, en particulier des membres des forces de sécurité, des responsables de camps et d'autres personnes en position d'autorité.
Les abris dans les camps sont faits de bâtons et de plastique et les personnes déplacées n'ont pour la plupart pas de vêtements en bon état. Les hommes approchent souvent les femmes et les filles pour leur proposer des actes immoraux en échange de nourriture ou d'un emploi.
« Des hommes viennent me voir pour me proposer de m'aider à trouver un emploi ou de la nourriture », raconte Iise. « Puis ils disent qu'ils veulent quelque chose en retour ».
Hawa, 70 ans (nom fictif), et sa petite-fille de trois ans vivent dans le camp d'Asal depuis sept mois. À son arrivée, elle a été l'une des rares personnes à bénéficier d'une aide humanitaire.
Mais les approvisionnements se sont taris en mai, après qu'elle a refusé une demande « immorale » de l'un des hommes qui gèrent le camp et contrôlent la distribution de l'aide.
« Les circonstances de ma vie actuelle dépassent l'imagination de quiconque. Il est difficile de croire à la raison pour laquelle je ne reçois plus d'aide alimentaire, mais c'est la vérité ».
Une vie de nomade brisée
« Le responsable du camp m'a demandé de me comporter de manière incorrecte si je voulais de la nourriture », raconte Hawa. « J'ai été choquée et je l'ai rejeté avec colère. Depuis, je n'ai pas reçu un seul grain de nourriture ».
Hawa affirme qu'il y a eu de nombreux cas similaires au sien. « C'est tellement triste », ajoute-t-elle.
« La situation est meilleure pour les personnes déplacées qui travaillent chez des particuliers, car ce sont les femmes qui restent à la maison tandis que les hommes vont travailler », explique Hawa.
« Les employeurs qui sont les plus gentils avec nous sont des femmes plus âgées. Ils nous donnent parfois de l'argent en plus ».
Maintenant qu'elle ne reçoit plus d'aide, Hawa quitte le camp tous les matins pour chercher du travail de nettoyage dans des chantiers de construction et des restaurants. Parfois, elle fait la lessive pour des familles des quartiers voisins.
Elle emmène généralement sa petite-fille au travail avec elle. Parfois, elle la confie à d'autres femmes d'Asal.
S'iido Hassan Moalim est l'une des femmes les plus désespérées du camp. Elle a été contrainte d'abandonner sa vie de nomade dans le district de Kuntuwaarey, dans le Bas-Shabelle, après que la sécheresse a asséché ses terres et détruit tout son bétail. Moalim n'est pas mariée et n'a jamais eu d'enfants. Elle a soixante-six ans et est malvoyante.
Laver les vêtements
« Je vis seule ici », soupire Moalim. « Je crois que je suis la personne la plus pauvre de ce camp. Je ne vois pas, je ne peux pas travailler et je n'ai pas reçu de bons pour l'aide alimentaire », se désole la sexagénaire.
Les voisins de Moalim partagent parfois ce qu'ils ont avec elle, mais elle n'a souvent rien. « Les faibles n'ont pas de droits », dit-elle.
Lisho Mukhtar Adam est arrivée dans le camp d'Asal à la fin du mois de juin 2023 après que les combats dans le district de Kuntuwaarey l'ont forcée à fuir sa maison avec ses trois jeunes fils. Elle a commencé à travailler comme femme de ménage et blanchisseuse presque immédiatement et parvient à acheter de la nourriture pour ses enfants avec ses revenus.
« Je lave les vêtements et nettoie les maisons de personnes plus aisées que moi », explique-t-elle. « Je gagne entre 1 et 2 dollars par jour. Je travaille de longues heures pour gérer au mieux la vie de ma famille ».
Adam explique que les personnes déplacées qui travaillent chez des particuliers sont parfois battues par leurs employeurs, qui les accusent parfois d'avoir volé leurs biens.
« À la fin de la journée, certains disent qu'ils n'ont pas d'argent pour nous payer et que nous devrions revenir le lendemain pour le récupérer », dit-elle. « D'autres ne nous paient pas du tout. Ils n'ont aucun respect pour nous. La plupart des employeurs nous méprisent, mais certaines personnes plus instruites nous traitent mieux ».
Elle affirme que l'aide apportée a été limitée. La police est généralement occupée à gérer les menaces que les terroristes d'Al Shabab font peser sur la sécurité de Mogadiscio.
« Personne ne nous écoute », regrette Mme Adam. La seule chose à faire est de parler de notre situation aux médias et d'espérer que quelqu'un ayant le pouvoir et les ressources nécessaires nous aidera », plaide-t-elle.
« La plupart des gens se taisent car ils savent que s'ils se plaignent, ils seront expulsés du camp ».
Je veux monter une affaire
Les personnes vivant dans l'un des plus anciens camps de déplacés de Mogadiscio, connu sous le nom d'Allah dhowr, souffrent de problèmes similaires à ceux d'Asal.
Rahma Mohamed y est arrivée avec son mari et ses quatre enfants en janvier 2022, après que la sécheresse a tué le bétail de la famille dans le district de Kuntuwaarey, dans le sud de la Somalie.
Chaque jour, Mohamed et son mari se lèvent tôt et se rendent à pied dans les quartiers environnants à la recherche d'un travail. Ils laissent leurs enfants à d'autres résidents du camp.
« Souvent, les personnes pour lesquelles je travaille me paient moins que ce que nous avions convenu », révèle t-elle. « Nous pouvons nous mettre d'accord sur 5 dollars, mais à la fin de la journée, ils ne me paient que 3 dollars ».
Malgré les difficultés rencontrées à Mogadiscio, Mohamed n'a pas l'intention de partir.
« Même si les gens me considèrent comme un réfugié, je veux créer ma propre petite entreprise ici pour subvenir aux besoins de ma famille ».
Asmo Abdi Farah Ahmed, 15 ans, allait à l'école coranique dans le district de Mushaan avant que la sécheresse ne l'oblige à fuir vers Mogadiscio en 2023. Aujourd'hui, elle travaille aux côtés de sa mère comme femme de ménage et lavandière.
« Les enfants des quartiers voisins de notre camp vont à l'école et jouent ensemble », dit-elle. « Parfois, ils se moquent de moi parce que je ne vais pas à l'école. Ils disent que je ne suis qu'une 'enfant du village' ».
Même ceux qui vivent à Mogadiscio depuis des années sont méprisés et considérés comme des résidents temporaires.
Une solution en vue
« Ici, les gens me considèrent toujours comme une personne déplacée, un réfugié, alors que je vis ici depuis 16 ans », affirme Mukhtar Abdalla Abdow, 60 ans. Il a fui sa région natale de Janaale il y a plus de 30 ans, d'abord pour la ville centrale de Galkayo, puis pour Mogadiscio. « Je me considère comme un habitant de la région », conclut-il.
« De nombreuses personnes déplacées de longue date ressemblent davantage à des citadins pauvres et ont des besoins différents de ceux des nouveaux arrivants », indique Refugees International.
Cependant, certains habitants de Mogadiscio, comme Juweeriya Mohamed Ibrahim, ont une attitude plus accueillante à l'égard des personnes déplacées.
« Je les vois comme des gens normaux qui sont venus ici parce que leur vie était menacée par les inondations, la sécheresse et le conflit », dit-elle. « Pour moi, s'ils vivent à Mogadiscio depuis plus de cinq ans, je les considère comme des résidents au même titre que moi ».
« D'autres disent souvent qu'ils sont des citoyens de seconde zone. Je crois fermement que ce n'est pas le cas », ajouté Mme ibrahim.
Pour résoudre les problèmes auxquels sont confrontées les personnes déplacées, le gouvernement somalien a annoncé un plan de réinstallation des personnes déplacées et d'amélioration de leurs conditions de vie.
Le Premier ministre Hamza Abdi Barre a lancé le plan d'action « National Solutions Pathways » le 4 septembre à Mogadiscio, suscitant l'espoir quant au sort des personnes déplacées. Le programme quinquennal devrait s'étendre de cette année à 2029.
« Le retour à la vie normale d'un million de Somaliens constituera une étape importante dans la recherche d'une solution durable pour les personnes déplacées, afin qu'elles puissent faire partie de la société et contribuer au développement du pays », a déclaré le Premier ministre.
L'auteur, Hinda Abdi Mohamoud, est rédactrice en chef de Bilan, le premier média féminin de Somalie, basé à Mogadiscio.
➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp