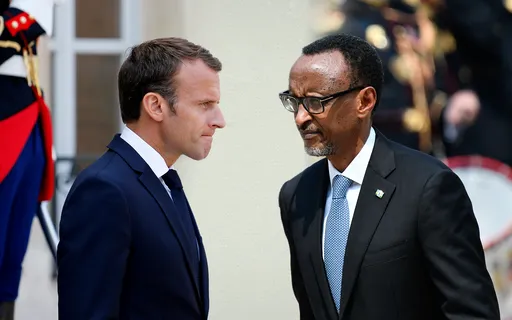Par Mariam Al Khateeb
Mes nuits sont agitées. Je n'ai pas dormi une nuit complète depuis un an. Avant, c'était le bruit des "bombes qui tombaient et les cris qui suivaient" qui m'empêchaient de dormir. Aujourd'hui, c'est le souvenir de ces nuits qui m'empêche de fermer les yeux dans ma petite chambre de Kafr el-Sheikh, à 130 km au nord du Caire, en Égypte.
Je suis ici depuis sept mois. Je n'étais pas censé rester ici aussi longtemps.
Je fais partie des « chanceux » qui ont réussi à franchir la frontière de Rafah avant qu'Israël ne la scelle en mai, emprisonnant des Palestiniens, dont mes parents, dans un camp de la mort.
La plupart du temps, lorsque je me lève le matin, il me faut un moment pour réaliser où je suis. Lorsque je réalise que je ne suis pas dans la chaleur de mon lit au camp de Nuseirat à Gaza, une douleur sourde me frappe au fond de la gorge et descend jusqu'au creux de l'estomac. C'est la douleur que j'ai connue sous le nom de manque de ma famille. Je me sens vide.
Gaza se meurt
Lorsque je rencontre d'autres personnes de Gaza déplacées ici (environ 100 000 d'entre nous ont fui vers l'Égypte depuis le début de la guerre), nous nous réunissons pour nous souvenir de notre maison, et toujours de notre désir de revenir.
Mais après un an de guerre, je perds espoir. Gaza est en train de mourir.
Même si ma famille trouve un moyen d'évacuer et de me rejoindre en Égypte, que se passera-t-il ? Nous avons tout perdu. Je pense à mes parents. Ils ont passé leur vie à essayer de construire une maison, d'offrir une éducation à mes frères et sœurs et à moi, malgré l'occupation. Maintenant ils n'ont plus rien et devront repartir de zéro.
Comment pouvons-nous repartir à zéro ? Nous portons une douleur appelée Gaza, une douleur appelée génocide.
Je continue à penser que nos vies se sont arrêtées en septembre dernier. C'est la dernière fois que nous avons pris des photos, apprécié les repas et la compagnie d'amis.
Le 7 octobre a tout changé.
Des bombardements incessants
C'était un samedi matin. Il y avait un événement à mon université auquel je me réjouissais d'assister avec mes amis.
Je me suis réveillée dans ma maison de Nuseirat au son des bombardements, mais ce n'est pas inhabituel à Gaza. Nous sommes toujours attaqués par Israël, mais le monde ne semblait pas se soucier de nous jusqu'à l'année dernière.
Je pensais que les raids ne dureraient que quelques heures, au mieux quelques jours.
Mais au lieu de cela, ils se sont intensifiés, et le bruit des bombes a été suivi par le son douloureux des cris des familles qui hurlaient après avoir perdu des êtres chers.
Au bout de deux jours, on nous a dit d'évacuer, que notre quartier allait être bombardé.
Nous sommes partis pour quelques jours seulement, d'abord à l'école locale de l'UNRWA, puis chez mon oncle à quelques rues de là, avant de revenir chez nous le 12 octobre. Il y avait eu des destructions, mais notre maison tenait encore debout.
Quelques jours plus tard, Israël a donné l'ordre d'évacuer tout le nord de Gaza. Ils venaient détruire nos maisons.
Lorsque nous sommes partis, personne n'imaginait que nous serions déplacés pendant un an.
"Tawala", c'est l'expression arabe pour dire "c'est trop long". C'est ce que tout le monde dit. Les bombardements continuent, des gens meurent chaque jour. Tout a cessé de fonctionner.
De nombreux jeunes qui se rendaient à l'école à pied chaque matin font désormais la queue pour aller chercher de la nourriture, de l'eau et de l'aide humanitaire pour leur famille.
Les tables des maisons de Gaza, autrefois garnies de plats palestiniens servis avec le sourire, sont devenues vides. Les maisons douillettes, toujours accueillantes, sont maintenant des tentes froides qui luttent contre les intempéries pour protéger ceux qui cherchent un abri à l'intérieur.
Quelque 1,9 million de personnes sont actuellement déplacées à Gaza, et nombre d'entre elles ont déjà été contraintes de déménager plusieurs fois au cours de l'année écoulée.
Il n'existe pas d'équivalent anglais au mot arabe "ma'jaat". Le dictionnaire dit "famine", mais c'est plus que cela. Personne ne peut imaginer ce que signifie la famine en 2024, et personne ne peut imaginer que des enfants mourront de faim et que des personnes seront tuées en cherchant de la nourriture.
Quitter Gaza
Le 6 mars, ma tante m'a téléphoné dans la matinée. Elle m'a dit que mon nom avait été appelé à la frontière. J'étais sur la liste. J'ai été autorisée à passer en Égypte pour poursuivre mes études de dentiste.
J'étais le seul membre de ma famille à partir, mon jeune frère et mes deux sœurs étant restés. Il était important pour mes parents que je poursuive mes études, afin de me préparer un avenir.
Mais en franchissant cette frontière, j'ai réalisé que j'avais laissé mon âme derrière moi. Je suis maintenant seule face au monde.
Je me sens accablée d'avoir quitté Gaza seule. J'ai fui une situation dangereuse dans mon pays, mais je ne vis pas mieux ici. Oui, j'ai échappé au danger, mais je n'ai pas de famille ici et je ne me sens pas en sécurité.
Parfois, je marche dans la rue et je commence à avoir des vertiges, alors j'appelle ma famille et je leur dis que je pense que je deviens folle.
Mon anniversaire a été doux-amer. J'ai eu 20 ans en juin, trois mois après avoir quitté Gaza. Avant la guerre, ma mère me préparait un gâteau, il y avait des décorations dans la maison et des cadeaux sur la table.
Cette année, ce sont les appels de tous les membres de ma famille qui ont survécu qui ont illuminé ma journée. Malgré les difficultés, ils ont trouvé le moyen de me faire fêter. Ils m'ont manqué davantage.
Ma vie là-bas et mon université me manquent. Les rues de la ville n'étaient pas les meilleures, mais c'était Gaza. Je ne sais pas ce qu'ils font chez eux, ni s'ils ont de quoi manger, ni même s'ils sont en vie.
D'ici, je sens l'odeur de la mort. Je me demande si c'est l'odeur des corps brûlés qui flottent dans l'air, capables de franchir les frontières sans les papiers nécessaires, ou si c'est la phantosmie - l'hallucination d'odeurs dont on se souvient.
Mais à d'autres moments, je ressens des effluves de Gaza - l'odeur unique des gens mélangée à l'odeur de la mer.
Ensuite, il y a l'odeur de la nourriture et des épices, les odeurs de la vieille ville de Gaza me reviennent. C'est une odeur dont on ne se débarrasse jamais. Dans mon esprit, je me promène dans les ruelles de la ville en respirant l'odeur de la cuisine qui y est réputée, en goûtant la nourriture de la rue Souq al Zawiya, bondée de monde à des occasions comme le ramadan, les vacances et les périodes où les gens se préparent pour l'université et achètent des vêtements. C'est l'endroit où l'on peut trouver tout ce que l'on veut.
Ce sont ces souvenirs qui me font vivre, mais après un an de guerre, je crains que nous ne perdions complètement la Palestine. Ce n'est pas seulement moi, c'est la peur qui vient à l'esprit de beaucoup de Palestiniens.
La guerre s'étend maintenant à la Cisjordanie occupée et au Liban. C'est ce qui nous effraie.
Avec le temps, les rêves des Palestiniens ont changé, passant du retour dans les maisons laissées lors de la Nakba (catastrophe) au retour dans les maisons perdues à Gaza. Le rêve de retourner dans ces maisons commence à s'évanouir.
Pour ceux qui sont encore là, j'entends "nous préférons mourir sous la poussière de Gaza plutôt que d'aller vivre dans n'importe quel autre pays".
Cette constance est leur force.
Pendant ce temps, je vis une vie de contradictions, qui me semble être un lourd fardeau. À l'université, j'interagis avec ceux qui m'entourent, je souris, comme si tout allait bien. Mais à chaque respiration, je ne pense qu'à Gaza - toute ma famille s'y trouve.
L'auteure, Mariam Al Khateeb, est une ancienne étudiante en médecine à Gaza. Elle est membre de We Are Not Numbers, un projet visant à aider les jeunes adultes de Gaza à partager leurs récits avec le monde occidental et à détruire les stéréotypes sur les Palestiniens.
Clause de non-responsabilité : les opinions exprimées par l'auteur ne reflètent pas nécessairement les opinions, les points de vue et les politiques éditoriales de TRT Afrika.
➤ Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp